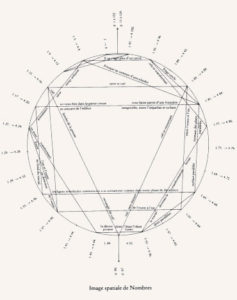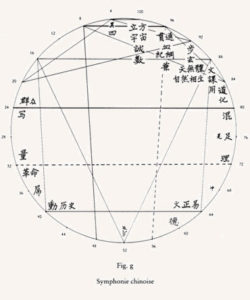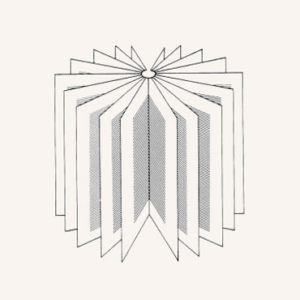Le thème de ce congrès « Place à la littérature à l’ère nucléaire » sous-tend quelque chose d’indéfini à quoi nous raccrocher : la peur. C’est paradoxal de se raccrocher à la peur, mais, remarque dans un tout autre contexte le psychanalyste Daniel Sybony, « quand on a peur, on a au moins quelque chose. » Cette chose si intime, nous la partageons avec d’autres. Cet avoir partagé, divisé, s’amenuise, on a moins peur. On s’appauvrit en quelque sorte. Or, les Japonais, les Européens, les Américains, les Russes et même les Chinois, qui jusqu’ici se moquaient de la bombe à cause de la densité de leur population, même les Chinois ont peur. Ce capital universel est le gouffre lui-même vers quoi nous courons, singulièrement pour nous y accrocher, comme si des aspérités (lesquelles ?) pouvaient retenir notre chute. Nous sommes actionnaire de la peur, c’est elle que nous devons « jouer » et déjouer, sur elle que nous devons compter et miser, elle que nous devons investir afin de produire, à court ou à long terme, de l’existence. Paradoxal aussi de sauver la peur, alors que d’ordinaire, dans la peur c’est le sauve-qui-peut. Mais sauver la peur, c’est nous faire sentir ce qui se dérobe sous nos pieds et que nous ne pouvons perdre sous peine de perdre pied. Il ne s’agit pas de jeux de mots fallacieux, mais de dire que perdre la peur, c’est devenir cet innocent au regard vide, aux mouvements sages, comme si de rien n’était, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, comme si la bombe n’était pas là, suspendue. On fait comme si, on marche, on sourit, on vaque, les Grands de la terre montent et descendent les passerelles des avions, serrent des mains, crachent des mots et se couchent tranquilles, comme si.
The Japan P.E.N. Club, in « The voice of the writer », Tokyo 1984